- Accueil
- Actualités
- Prix Nobel de Physique 2025 : Comment La Découverte de L’effet Tunnel Macroscopique Inspire L’X Aujourd’hui
Prix Nobel de Physique 2025 : comment la découverte de l’effet tunnel macroscopique inspire l’X aujourd’hui
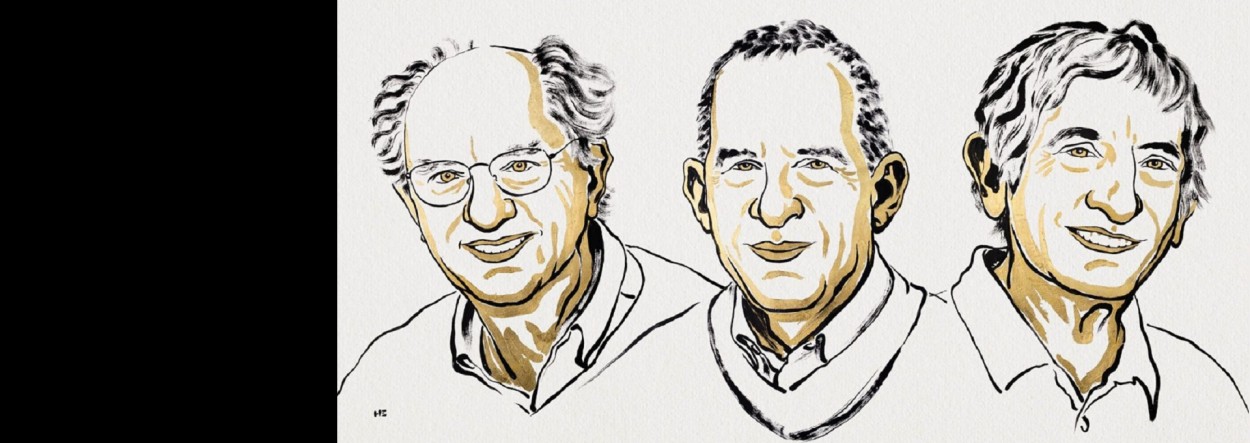 Les lauréats du Prix Nobel de Physique 2025: John Clarke, Michel Devoret et John Martinis. Illustration : Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach
Les lauréats du Prix Nobel de Physique 2025: John Clarke, Michel Devoret et John Martinis. Illustration : Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach
Ce 8 octobre, le prix Nobel de Physique 2025 a été décerné à un trio de physiciens pour « la découverte de l'effet tunnel quantique macroscopique et de la quantification de l'énergie dans un circuit électrique ». Parmi ces lauréats se trouve Michel Devoret, un chercheur très familier avec le plateau de Saclay puisque son parcours inclut un diplôme d’ingénieur à l’École nationale supérieure des télécommunications (maintenant Télécom Paris) et plus tard un doctorat au centre de recherche CEA Paris-Saclay. Depuis longtemps directeur de recherche à l’université de Yale aux Etats-Unis, son influence n’a cependant pas cessé de se faire ressentir en France et ailleurs, jusque dans les locaux même de l’École Polytechnique.
Pour expliquer l’impact de ses travaux avec ses co-lauréats John Clarke et John Martinis, nous avons interrogé deux chercheurs de l’équipe QCMX du laboratoire de Physique de la Matière Condensée (PMC) à l’X. Landry Bretheau et Jean-Damien Pillet connaissent bien le sujet, ayant tous deux effectués leur doctorat dans le groupe Quantronique au CEA Saclay, groupe co-fondé par Michel Devoret.
Qu’est-ce que l’effet tunnel quantique macroscopique et la quantification de l'énergie dans un circuit électrique?
L’importance de cette découverte récompensée par le prix Nobel ne repose pas, comme parfois perçu à tort, sur l’effet tunnel quantique lui-même (qui a donné lieu à des précédents prix Nobels comme en 1973) mais bien sur le mot « macroscopique ». En effet, leurs travaux ont prouvé qu’un circuit électrique, visible à l’œil nu et donc à l’échelle macroscopique, pouvait montrer les mêmes comportements quantiques que des atomes ou d’autres objets à l’échelle microscopique.
« Dans un atome, les énergies sont quantifiées, c’est pour ça qu'on dit mécanique quantique », explique Jean-Damien Pillet, professeur et chercheur à l’École Polytechnique. « Cette caractéristique marche pour les objets quantiques très élémentaires comme les atomes. Ce qu’ils ont montré, c'est que ça marchait aussi pour un très gros système, un circuit électrique supraconducteur. »
Quand on dit que les énergies d’un atome sont quantifiées, cela veut dire que les énergies adoptent des valeurs très précises et ne fluctuent pas sur une fourchette continue de valeurs possibles. Pour prendre un exemple extrêmement simplifié, cela signifie que sur une échelle de 1 à 10 cela revient à choisir systématiquement les valeurs 2, 4 et 10 et non varier sur l’infinité des valeurs possibles entre 1 et 10. On peut donc analyser, mesurer, et même influencer la valeur précise de l’énergie d’un atome.
Avant ces expériences, cette possibilité ne faisait pas un consensus unanime pour les objets macroscopiques. En effet, la notion qu’un circuit électrique, avec des milliards de milliards de milliards d’électrons parcourant ses fils, puisse adopter des valeurs d’énergie très précises et ne pas varier selon une fourchette de valeurs peut sembler contre-intuitive.
« Un circuit macroscopique supraconducteur, composé d’un nombre considérable d’atomes et d’électrons, peut donc être décrit par un schéma de niveaux d’énergie extrêmement élémentaire », continue Landry Bretheau, également professeur et chercheur à l’X. « La physique quantique devrait me dire que chacun de mes électrons va avoir des niveaux d'énergie. Mais grâce à la supraconductivité, on obtient un seul état quantique macroscopique pour tout le circuit plutôt que pour un pour chaque électron. Pour simplifier, c’est comme si le circuit électrique tout entier ne se comportait que comme un seul gros atome avec un seul niveau d’énergie ».
La supraconductivité est une caractéristique des circuits électriques exposés à des températures extrêmement froides, proches du zéro absolu (−273,15 °C), ce qui induit une annulation de la résistance électrique et donc une conservation de l’électricité sans perte d’énergie. D’un point de vue quantique, les électrons d’un tel circuit s’apparient deux par deux et condensent dans un seul état macroscopique, ce qui explique leur comportement collectif.
Et l’effet tunnel macroscopique dans tout ça ? Michel Devoret, John Clarke et John Martinis l’ont observé en créant des jonctions dites « Josephson », composants clés des circuits électriques supraconducteurs, à l’aide d’une couche de matériau isolant. Dans leur expérience, le circuit électrique transite d’un état où la tension aux bornes de la jonction Josephson est nulle (V=0) vers un état où la tension électrique est non nulle (V≠0). Cette transition entre ces deux états macroscopiques différents pour le circuit a lieu par effet tunnel, c’est-à-dire en franchissant une barrière d’énergie. Dans une deuxième expérience, ils ont montré que cet effet pouvait être magnifié en excitant le circuit à certaines fréquences bien précises, démontrant ainsi que le circuit électrique est quantifié en niveaux d’énergie, avec un effet tunnel donc macroscopique.
Cette découverte pionnière va se révéler cruciale dans le développement de technologies qui rythment déjà notre présent - comme la conception de futurs ordinateurs quantiques - mais il faudra encore probablement bien des années pour que le grand public se rende compte de son impact.
Un héritage aussi bien humain que scientifique
Peu après ces travaux publiés en 1984 qui mèneront à ce prix Nobel quarante ans plus tard, Michel Devoret reviendra en France créer, avec Daniel Esteve et Cristian Urbina, le groupe Quantronique (QUANTum electRONIQUE) au centre de recherches du CEA Saclay. Au lieu d’intégrer des équipes existantes et suivre la norme, le CEA leur a alors fait confiance malgré leur jeune âge pour démarrer une équipe de zéro - un fait rarissime dans le monde de la recherche – afin d’explorer ce domaine auparavant quasi-inconnu que sont les circuits supraconducteurs. Et l’héritage de ce groupe se fait ressentir plus que jamais aujourd’hui. « C’était un domaine très niche, il y avait extrêmement peu de gens dans le monde qui travaillaient là-dessus », raconte Jean-Damien Pillet. « Et c’est resté niche très longtemps, période durant laquelle le groupe Quantronique était un des meilleurs du monde dans ce domaine qu’ils avaient initié. »
Ce groupe de recherche pionnier sera par exemple à l’origine d’un des tous premiers qubits supraconducteurs, marquant le premier pas vers de futurs ordinateurs quantiques. La qualité de cette équipe de recherche au CEA était telle que Michel Devoret fut invité en 2002 à créer et diriger une équipe similaire cette fois-ci à la prestigieuse université américaine de Yale, ou il est encore professeur aujourd’hui. Durant les années suivantes, il continuera de créer des équipes en France et ailleurs pour explorer toutes les facettes des circuits supraconducteurs. Il encouragera également les jeunes chercheurs à se lancer et soutiendra même les besoins en équipement de ces laboratoires à peine nés, comme l’équipe QCMX - Quantum Circuits & Matter – créée par Landry et Jean-Damien en 2017 à X et soutenue par la Fondation de l’École Polytechnique. « À notre démarrage, Michel nous a aidé afin qu’on se procure de l’Helium 3 auprès du Department of Energy des États-Unis », se souvient Landry Bretheau. « Il y a aujourd’hui un formidable héritage avec un grand nombre d’équipes dans le monde travaillant dans ce domaine. C’est assez fantastique ».
Quelques années plus tard, ce domaine des circuits supraconducteurs explose avec la création de larges groupes de recherche américains et chinois, et des géants américains de la technologie tel qu’IBM, Google ou Microsoft s’y plongent. Mais les chercheurs académiques n’oublient pas les origines de ce domaine de recherche novateur. « Une fois parti aux USA, Michel a bien sûr moins publié dans sa recherche en France mais son esprit, sa profondeur, a continuellement infusé les groupes de recherche ici par ses séminaires et ses discussions », continue Jean-Damien Pillet.
L’impact de ces travaux à l’École Polytechnique
L’équipe QCMX à l’X descend en ligne directe des travaux de Michel Devoret puisque ses fondateurs, Landry Bretheau et Jean-Damien Pillet, sont tous deux doctorants issus du groupe Quantronique cocréé par celui-ci au CEA. Avec leur équipe, ils continuent également d’explorer les circuits électriques supraconducteurs au niveau macroscopique mis en avant depuis 1984.
Ces circuits électriques peuvent donc grâce à la supraconductivité être manipulables pour atteindre certains niveaux d’énergie. Un système à deux niveaux d’énergie peut être considéré comme un bit quantique, équivalent au 0 et 1 dans un bit classique, et peut donc être utilisé comme porteur d’information. On appelle un tel système un qubit, qui deviendra l’unité de base de l’ordinateur quantique. Grâce à leurs équipements ultra-performants tel que leurs cryostats permettant de descendre à une température très proche du zéro absolu et des techniques de lithographies avancées, les chercheurs de l’X peuvent designer et tester leurs propres qubits. Leurs avancées ont par exemple abouti récemment à la création d’un nouveau type de qubit supraconducteur, basé sur un nanotube de carbone, ce qui pourrait générer des applications novatrices.
Un autre centre d’intérêt pour ces chercheurs est de comprendre et explorer l’effet dit Josephson, à la base des jonctions du même nom. Pour cela, ils utilisent des dispositifs couplant circuits supraconducteurs et nanostructures, comme les nanotubes de carbone, afin de sonder et contrôler l’effet Josephson à l’échelle élémentaire de la paire d’électrons unique.
« Michel a exploré des circuits électriques macroscopiques composés de millions de particules microscopiques. Maintenant nous essayons d'utiliser ces objets macroscopiques pour isoler un objet microscopique », conclut Jean-Damien Pillet. « On essaie un peu d’inverser l’histoire. »
 Je soutiens l'X
Je soutiens l'X