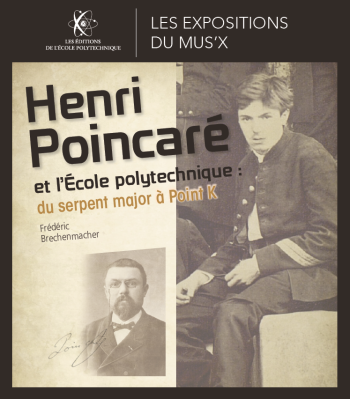Dans Une étrange victoire, l’extrême droite contre la politique, Michaël Foessel et Étienne Ollion analysent les transformations du paysage politique contemporain. Les auteurs explorent les changements dans les repères politiques classiques, comme le clivage gauche-droite, et montrent comment ces transformations ont contribué à rendre l’extrême droite plus acceptable pour une partie de l’électorat. Le livre aborde également les effets de ces évolutions sur l’espace public et le débat politique. Cet ouvrage invite à réfléchir aux mutations des cadres politiques et à la manière dont elles redéfinissent les contours de la démocratie contemporaine.
- Accueil
- Éducation
- Départements D’enseignement et de Recherche
- Département Humanités et Sciences Sociales
- La Recherche En Humanités et Sciences Sociales
La recherche en humanités et sciences sociales

Les activités de recherches du département HSS se développent dans le cadre du LinX, Laboratoire interdisciplinaire de l'X : recherches en humanités et sciences sociales.
Actualités de la recherche
Charles Hermite (X 1842)
15 mai 2025
Numéro spécial de la Revue d'histoire des mathémaitiques, coordonné par Catherine Goldstein (IMJ-PRG, CNRS, Sorbonne Université, Université Paris Cité) et Frédéric Brechenmacher (LinX, École polytechnique, IPParis).

« Nous sommes tous les héritiers d'Hermite », affirmait le mathématicien grec Cyparissos Stephanos (1857-1917), qui étudia avec Hermite à Paris dans les années 1880. Et cela serait probablement encore plus vrai aujourd'hui. Les bases de données MathSciNet et zbMATH contiennent plus de 5 500 articles, publiés entre 1950 et 2024, dont le titre inclut le nom « Hermite », et plus de 6 000 articles dont le titre inclut l'adjectif dérivé « hermitien ». Ils appartiennent à une variété impressionnante de domaines, de la théorie des nombres à l'analyse numérique, de l'algèbre linéaire à l'informatique, de l'analyse fonctionnelle à la théorie des probabilités, de la mécanique des fluides aux équations aux dérivées partielles ou ordinaires et aux fonctions spéciales. On y trouve les inégalités d'Hermite, une constante d'Hermite, les polynômes d'Hermite, les schémas d'Hermite, des formes, matrices ou variétés hermitiennes…
La carrière d'Hermite ne fut cependant pas de tout repos. Né à Dieuze (Lorraine) le 24 décembre 1822, dans une famille de commerçants, il étudia à Nancy, puis à Paris, et fut admis à l'École polytechnique en 1842. Il quitta Polytechnique seulement un an plus tard en raison d'un handicap qui le rendait inéligible aux carrières attendues des polytechniciens. Dès cette époque, Hermite commença à publier des travaux sur un sujet central, les fonctions elliptiques, en lien avec l’un des mathématiciens le plus important du temps, Carl Gustav Jacobi, avant d’investir les champs de la théorie des nombres, des invariants et des équations algébriques par des recherches s’inscrivant dans un réseau international de savants tels que Gotthold Eisenstein, Carl Borchardt, Peter Gustav Lejeune-Dirichet, James Sylvester et Augustin Cauchy. Sur la scène française, il dut pourtant se satisfaire durant de nombreuses années d’une modeste position de répétiteur à l’École polytechnique, obtenue en 1848, avant d’acquérir progressivement une position institutionnelle centrale sur la scène mathématique parisienne : élu à l’Académie des sciences en 1856, maître de conférence à l'École normale supérieure en 1862, titulaire de la prestigieuse chaire de professeur d’analyse à l’École polytechnique de 1869 à 1876 - il y aura notamment Henri Poincaré pour élève - puis à la la Faculté des sciences de Paris, la Sorbonne, d'où il ne prit sa retraite qu'en 1892. A partir des années 1870, Hermite étendit ses sujets d’intérêts aux équations différentielles avec notamment la première preuve en 1873 de la transcendance d’une constante naturelle de l’analyse, le nombre e.
Ce numéro spécial de la Revue d’histoire des mathématiques réunit des spécialistes de différentes branches de l’histoire des mathématiques. Il vise à mettre en lumière des aspects moins connus de l’œuvre d’Hermite, tels que la théorie des invariants et les équations numériques, ainsi qu’à explorer plus en détail ses conceptions des mathématiques à travers une étude de son style d’écriture, du rôle clé joué par une approche concrète de l’analyse et de sa manière de construire une unité des mathématiques. La préférence d’Hermite pour les formules effectives et les transferts par analogie de l’arithmétique à l’algèbre puis à l’analyse contrastent avec le développement contemporain des programmes fondationnels, des objets abstraits et des cadres généraux. Prendre au sérieux la manière dont Hermite concevait les mathématiques, leur organisation disciplinaire, l'introduction de nouveaux sujets d'étude, ainsi que ses convictions en matière de preuve et de résultats, invite à repenser le développement des mathématiques au XIXe siècle.
Une étrange victoire, l’extrême droite contre la politique
18 octobre 2024
par Michaël Fœssel, professeur de philosophie à l'École polytechnique et directeur du LinX
et Étienne Ollion, directeur de recherche CNRS au CREST et professeur chargé de cours en sociologie à l'École polytechnique.
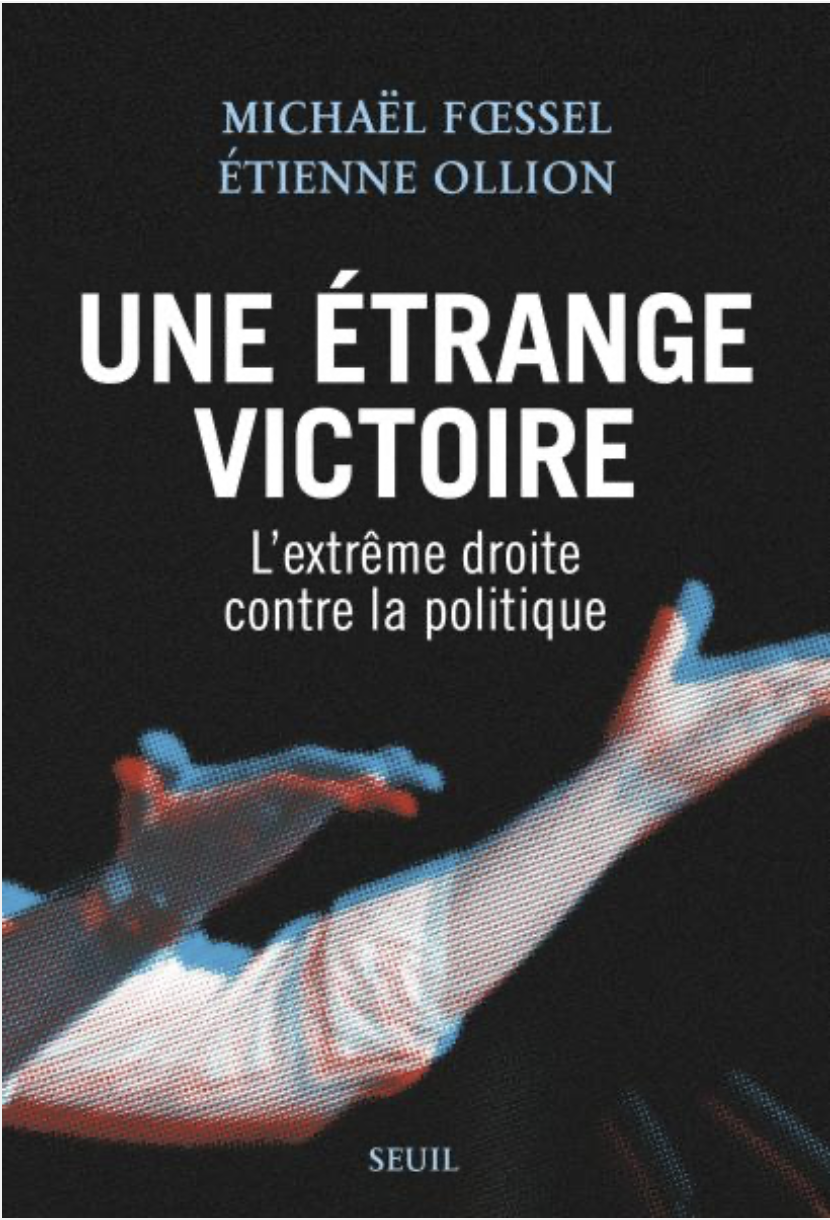
Henri Poincaré et l’École polytechnique : du serpent major à .K
1er septembre 2024.
Le catalogue de l'exposition "Henri Poincaré et l'École polytechnique, du serpent major à Point K" est paru aux éditions de l'École polytechnique.
Réalisée à l'occasion du 150e anniversaire 🎊🎉de l'entrée de Poincaré à l'X, l'exposition nous invite tout d’abord à franchir le seuil de l’École polytechnique de 1873 (1ère partie). La seconde partie de cette exposition s’attache aux nombreux liens que Poincaré entretient avec son école durant sa carrière savante.👨🏫
125 pages, très richement illustré, le catalogue est disponible sur le site des éditions :
https://www.editions.polytechnique.fr/?afficherfiche=275
Auteur : Frédéric Brechenmacher, professeur d'histoire des sciences, président du département Humanités et sciences sociales.
Préfacé par Laura Chaubard, directrice générale et présidente de l’X par intérim.
Sciences et fiction
29 août 2024
Connaître et agir par la fiction.
Colloque pluridisciplinaire du LinX. 26-27 septembre 2024
École polytechnique - Amphi Lagarrigue.
Organisation : Nicolas Wanlin et Ismaël Moya
Le mot fiction évoque le plus souvent le récit, l’art du roman et le cinéma. Et lorsqu’on l’associe au mot science, c’est parce que l’on pense au genre de la science-fiction ou parce que les fictions peuvent prendre pour thème les sciences et pour personnages des scientifiques.
Mais la fiction est d’abord une compétence psychologique, voire une disposition anthropologique. Elle peut s’actualiser dans diverses pratiques (notamment artistiques, mais pas seulement) et plusieurs disciplines scientifiques. Dans les fictions narratives, la frontière qui sépare le fait de la fiction gagne à être reconnue, au contraire d’une contamination de la réalité par la fiction ou d’une indistinction relativiste: la distinction entre le monde réel et les mondes possibles est la condition nécessaire pour que ceux-ci enrichissent celui-là. Sans ignorer ce que la littérature, le cinéma, le théâtre ou encore les jeux vidéo apportent à notre compréhension de la fiction, il s’agira ici d’interroger l’usage que les sciences font de la fiction.
La fiction implique l’imagination, la supposition, la déduction, puis la formulation, l’énonciation, voire la narration. Mais dans le cadre qui nous intéresse, ce qui définit la fiction est un écart assumé, revendiqué à la réalité ou à l’observation. De la fictio juridique romaine aux nombres imaginaires des mathématiques en passant par les voyages lunaires dans l’astronomie du XVIIe siècle et le recours des historiens à l’imagination, la fiction est, entre autres, une technique pour comprendre ou agir sur le réel en rompant ostensiblement avec lui.
Contrairement à ce que pourrait faire penser une vision étroitement positiviste, la fiction participe des pratiques, outils ou méthodes scientifiques depuis longtemps si ce n’est depuis toujours, tout comme elle est au cœur d’institutions sociales comme la nation (roman national), le droit (fiction juridique) et bien entendu le marché (marchandises fictives, robinsonades, homo-oeconomicus etc.) ou encore l’état (théorie du contrat social, des deux corps du roi, etc.). Seulement, elle ne se dit pas forcément sous ce nom de fiction. Employer ce mot suggère que l’on voit quelque chose de commun entre différentes pratiques de diverses disciplines qui, d’une manière ou d’une autre, sont confrontées à la performativité de la fiction. Mais où situer les terrains partagés, les carrefours et les bifurcations?
Ce colloque sera l’occasion d’ouvrir la discussion en interrogeant l’écart paradoxal entre le réel et la fiction afin d’appréhender quelle unité pourrait avoir ce concept ainsi que les différences qui séparent les usages disciplinaires.
Retrouvez le programme détaillé sur le site du laboratoire LinX
Ce qui échappe à l'intelligence artificielle
15 mai 2024
sous la direction de François Levin, doctorant en philosophie au LinX et Étienne Ollion, directeur de recherche CNRS au CREST et professeur en sociologie à l'École polytechnique.
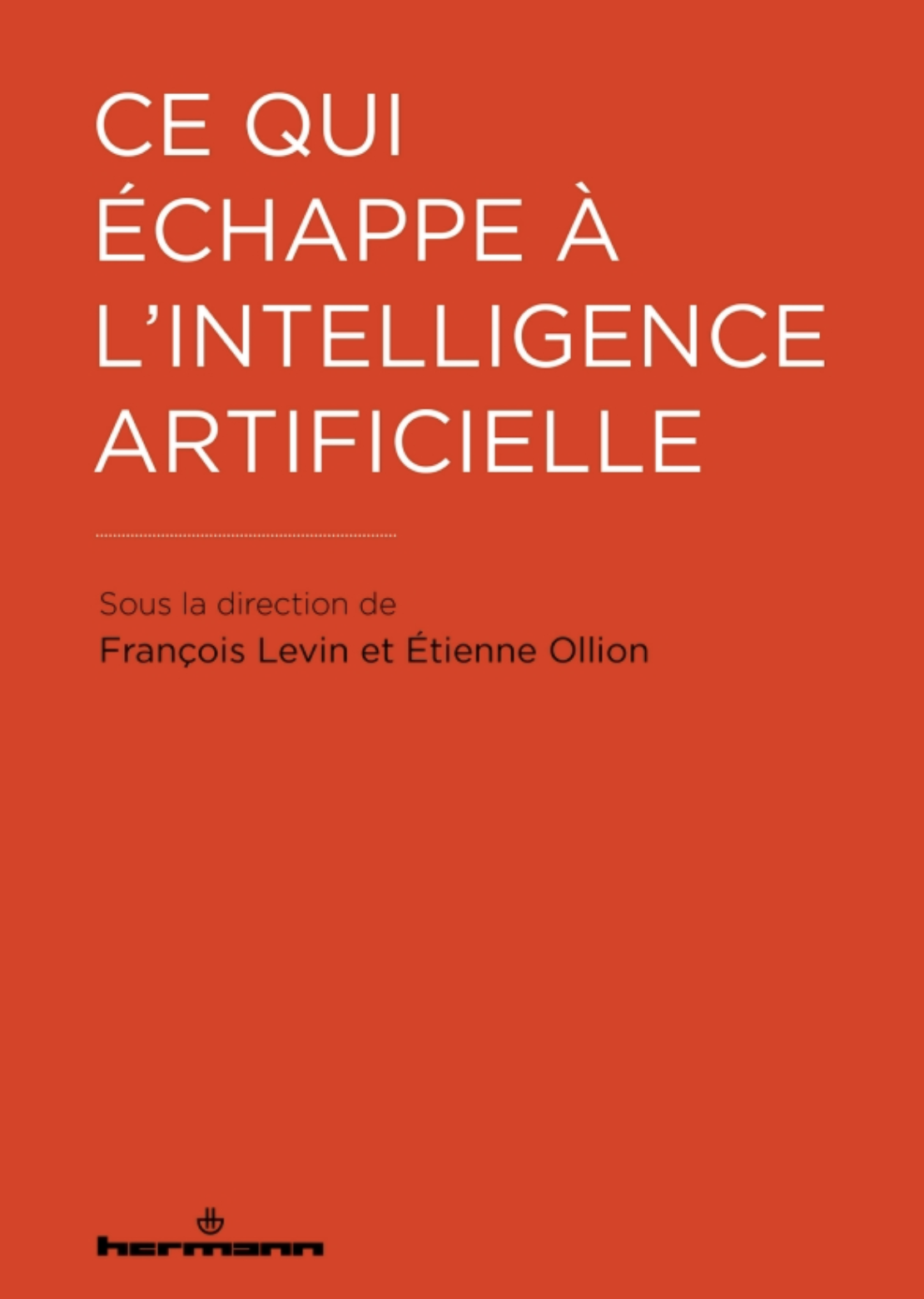
L’intelligence artificielle est désormais partout, et son développement semble ne connaître aucune limite. Pas un mois ne se passe sans qu’une frontière que l’on pensait insurmontable ne soit allègrement franchie.
Plutôt que de se demander quelle sera la prochaine à être dépassée, ce livre interroge sur ce qui échappe, de manière profonde, à l’IA. Existe-t-il des bornes absolues, au-delà desquelles l’IA ne pourrait se rendre ? Des domaines de la vie qui lui seraient inaccessibles, comme l’amour, la colère, la pensée, la création, la rencontre, la signification ? Ou ces états sont-ils simplement des bornes contingentes, prêtes à être outrepassées grâce au flux de données et à la puissance des algorithmes d’apprentissage machine ? Mais peut-être que la distinction se joue encore ailleurs, non dans des domaines spécifiques, mais dans une certaine expérience du monde qui différerait fondamentalement entre l’humain et la machine.
Pour répondre à ces questions, et afin de comprendre pourquoi nous tenons tant à déterminer des limites à l’intelligence artificielle, ce livre rassemble des contributions interdisciplinaires : recourant à la philosophie, aux sciences sociales et à l’informatique, il tente de donner un sens au sentiment d’étrangeté que nous ressentons face au développement fulgurant des dispositifs intelligents.
 Je soutiens l'X
Je soutiens l'X